Éloge de Jean-Claude Reverdy (1934–2012)
Les travaux d’éditions sont des voyages au long cours. Je découvris Arabia deserta de Doughty en traduction française1, alors que j’étais sur le terrain dans le Hedjaz, lors de ma seconde enquête en Arabie, en 1980. J’acquis rapidement les deux gros volumes du texte intégral en anglais, facilement disponible en reprint, ainsi que différentes éditions des Passages qu’Edward Garnett en avait extraits2 — ouvrage sorti en traduction française en 1947 par les éditions Payot, celles-là même qui avaient publié, dans l’entre-deux-guerres, nombre de textes sur le Moyen Orient, et notamment les légendaires Sept piliers de la sagesse de Th. E. Lawrence3. Quand, dans les années 1980, la vénérable maison chercha à moderniser son image sur le marché des sciences sociales, mon ami Dominique Colas y fut engagé comme conseiller éditorial. Cet aggiornamento appelait de nouveaux auteurs, mais il s’agissait aussi de valoriser le catalogue, et c’est dans cet esprit que je proposai de ressortir le texte de Doughty dans une version mise à jour.
Je me rendis vite compte qu’une révision, même limitée, de la traduction de Jacques Marty impliquait un travail pour lequel je n’étais guère qualifié. Je me limitai donc à ajouter un texte critique qui restituait la place remarquable de Doughty dans l’histoire du voyage en Arabie et sa contribution à l’anthropologie des Bédouins. Il ne pouvait figurer comme préface, la place étant déjà occupée par un texte de Th. E. Lawrence qui en avait préparé et popularisé la republication en anglais en 1921. Ce fut donc un consistant « dossier critique », avec une bibliographie à jour et une chronologie4, placé en annexe du livre, ce qui permettait de conserver la pagination de l’édition originale5. Le livre fut publié en 1990, puis dès 1994 en édition de poche.
C’était bien peu par rapport au monument littéraire et viatique que constituaient les Travels. Il y eut quelques échos de presse, notamment un compte rendu dans Le Monde (22.6.1990) et, plus tard, un autre infiniment perspicace, comme son auteur, Daniel Nordman, dans les Annales6. Sur la suggestion de Françoise Héritier, je déposai un appel à traduction de l’ouvrage complet auprès du Conseil National du livre, qui fut agréé. L’information ne passa évidemment pas car c’est seulement le 25 février 1995, au-delà des délais d’agrément possible, que je recevais une lettre fort dense d’un certain Jean-Claude Reverdy, sociologue travaillant comme expert dans un organisme de développement, la SOGREAH, spécialisé dans les aménagements d’hydraulique rurale et urbaine un peu partout dans le monde. Sur quatre pages d’une écriture serrée, il me racontait, comme en confidence, comment il avait découvert Arabia deserta lors d’une longue mission en Arabie saoudite, en 1968, quand il avait été conduit à fréquenter les territoires du Hedjaz sillonnés jadis par Doughty et Lawrence ; comment il s’était vite reporté au texte intégral, acquis en reprint, qu’il fréquenta dès lors intensivement. Il m’expliquait enfin comment, trouvant la traduction de Marty véritablement mutilante, il s’était engagé à en élaborer une nouvelle qui tentait de respecter les ambitions d’écriture de son auteur.
Je lui dis immédiatement mon enthousiasme, l’assurai de mon complet soutien, et c’est sur cette base que nous nous rencontrâmes lors d’un de ses passages à Paris : il habitait régulièrement sur les hauteurs de Nice où je vins également le visiter au cours de l’été 1995. Partageant des souvenirs et échangeant dès lors régulièrement sur Doughty, nous sommes devenus peu à peu des amis. Je lui fournis évidemment toute la documentation que j’avais rassemblée pour l’écriture de ma postface, notamment ce qui venait de l’érudition historique et anthropologique en langue anglaise. Cela le conduisait du côté des voyageurs du xixe siècle et de la multitude des travaux et rééditions que l’on avait vu fleurir à partir des années 1970. Il dépouilla tout cela pour en faire son miel, comme une mise en contexte de son héros.
Je m’attachai à l’aider de mon mieux, non pas pour la traduction proprement dite mais dans les choix stratégiques qu’il avait à faire à ce sujet, notamment sur le rapport de l’anglais à l’arabe que Doughty utilisait non pas en équivalent simple, c’est-à-dire en traduction, mais en écho, ou pour compléter son information historique et ethnographique. Je l’engageai aussi à réaliser un travail complet sur le texte incluant la préface de Lawrence (un homme qu’il n’aimait guère) ainsi que sur l’important index des matières qui, avec le glossaire des termes arabes, comptait près de 5000 entrées — 120 pages du texte original — et constituait par lui-même une source importante. Je l’engageai enfin à réaliser des notes explicatives sur sa traduction — ce qu’il avait scrupule à faire — et sur le contenu du texte, notes que je relus avec attention. Je déclinai évidemment la proposition qu’il me fit de rédiger une préface, non seulement parce que j’avais écrit ce que j’entendais dire sur Doughty, mais aussi parce qu’il fallait que le mérite de l’éclairage de l’ouvrage lui revienne en entier. Il rédigea donc un « avant-propos du traducteur » donnant toute la mesure du texte et de sa traduction. Il restait à trouver un éditeur.
Comme il avait conduit son travail, pour ainsi dire, à ses moments perdus, cela avait pris des années. Même s’il ne put véritablement l’achever et assurer les interminables révisions et les travaux documentaires complémentaires qu’après qu’il ait pris sa retraite, il avait quand même en main une première version de sa traduction quand il prit contact avec moi. On avait passé les échéances pour l’aide que j’avais obtenue auprès du CNL, mais il espérait avoir quelque rémunération, fût-elle symbolique, pour son énorme travail, et il ne fallait donc pas trop dire que la tâche était quasi-achevée. Ce flou artistique n’aida guère pour l’avancement du dossier. Courageux mais pas téméraires, les « grands » éditeurs ne réagirent pas. Sans doute avaient-ils en tête qu’un marché pour le Sahara existait en pays francophone, en raison du souvenir de la colonisation (et de la coopération) puis du tourisme, mais que la péninsule Arabique qui était restée sous mouvance anglaise (ou anglophone, si on compte la présence dans la région des compagnies pétrolières américaines) faisait moins recette. Les dossiers envoyés restèrent, pour la plupart, sans réponse.
La négociation la plus sérieuse fut conduite auprès de Plon, dont la collection « Terre humaine » était le destinataire naturel de ce livre. J’avais rencontré son directeur Jean Malaurie grâce à Pierrette Crouzet, alors son assistante, qui m’avait convié à contribuer par un texte placé, comme c’est le cas pour beaucoup de titres de la collection, en annexe du Désert des déserts de Wilfried Thesiger8 (1982). La publication du Doughty se plaçait dans ce sillage. Malaurie prépara un dossier pour le CNL avec un chapitre traduit qu’il fit expertiser par la grande spécialiste de sciences sociales qu’est Amy Jacobs-Colas. La dimension du texte appelait un volume double, ce qui ne se faisait pas dans la collection. Mais Malaurie espérait trouver un financement du côté de l’islam pétrolier. C’est qu’il n’avait pas regardé d’assez près le texte de Doughty, qui comporte diverses imprécations contre l’islam et son prophète (qualifié de « fatal ismaélite »), des récits des manifestations d’intégrisme que l’on rencontrait dans les villes du Nejd wahhabite, et, ce qui est peut-être pire, une description de la tiédeur religieuse manifeste de la plupart des Bédouins. Mais ce qui compromit définitivement le projet, c’est qu’un beau jour, Reverdy, confronté au téléphone à un interlocuteur qui se présenta solennellement comme le « Professeur Malaurie », avoua que cela ne lui disait rien. Auprès d’un homme qui republiait tous les cinq ans son livre sur les esquimaux sous un volume chaque fois doublé, cette distraction était inacceptable.
Nous désespérions de l’édition française, quand j’eus l’idée d’en parler au directeur de Karthala, Robert Ageneau, bien que le texte de Doughty semblât en décalage avec ce qui constituait le centre de gravité du catalogue de sa maison. Je ne sais pas par quels arguments j’obtins son adhésion complète — il résuma plus tard cet engagement par une formule généreuse : « C’est un ouvrage de fonds ! ». Il acceptait donc de prendre le livre — près de 1500 pages — à la condition que Reverdy lui fournisse le document prêt à clicher et que son travail de traduction soit rémunéré uniquement par un pourcentage sur les ventes. Pour le reste, il sortait l’ouvrage sous couverture cartonnée, en quadrichromie, avec un fac-similé de la grande carte en couleur dessinée à partir des informations topographiques rapportées par Doughty. Malgré la subvention obtenue auprès du CNL et l’aide de l’EHESS, qui s’engageait à acquérir un certain nombre d’exemplaires de l’ouvrage, c’était un pari risqué. De fait, en dépit de la campagne d’information que j’organisais auprès des spécialistes des voyages et des anthropologues du monde arabe, à laquelle vinrent s’ajouter une séance de présentation à l’Institut du monde arabe et une journée d’études à l’EHESS, les ventes restèrent limitées.
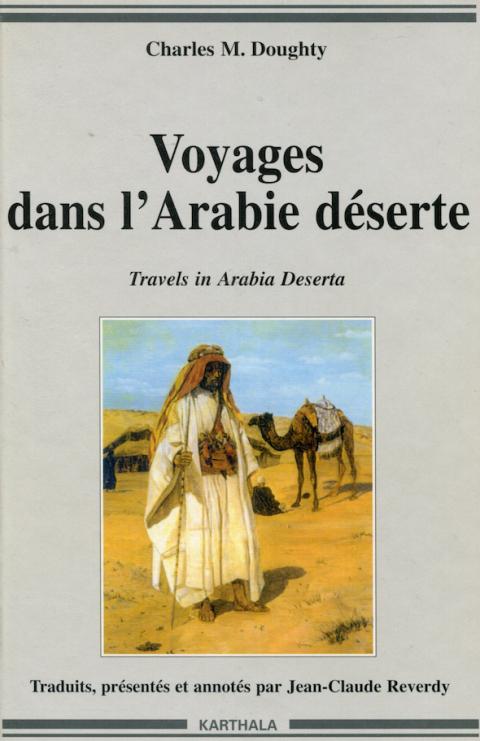
L’effort peu commun qu’il avait fourni9 pour réussir la sortie d’un livre ne devait pas s’interrompre ensuite. Il voulut même se lancer dans une entreprise plus large. Entre 2003 et 2008, à peu près chaque année, il vint régulièrement présenter, dans le cadre de mon séminaire de l’EHESS, les étapes de ce qui était les pièces d’un ouvrage de synthèse sur le voyage en Arabie à la fin du xixe siècle10. Après 2008 malheureusement, en raison d’une rapide dégradation de sa santé, son travail se ralentit. Nous sommes cependant restés en contact téléphonique régulier, tant que c’était possible, car il passa ses derniers mois avant sa mort, survenue en 2012, dans une institution spécialisée qui le mettait à l’abri de lui-même
Il faut s’arrêter un peu sur la formidable traduction que réalisa Jean-Claude Reverdy. Celle-ci constituait sans doute un travail considérable à cause de la taille du texte, mais aussi de la difficulté technique qu’il présentait. On sait l’entreprise stylistique véritablement folle que constitua l’écriture de Doughty. Elle se prépara dès ses études à Oxford à la Bodleian Library avec une mise en fiche de termes et de tournures de l’anglais ancien, et se prolongea au-delà de son livre de voyages, avec la composition d’odes métaphysiques qu’il publia, sa vie durant, dans une indifférence générale que la postérité respecta. Restaurer dans l’Angleterre postromantique une écriture archaïsante, trouvant notamment ses modèles dans des textes des xve ou xvie siècles, constitue une bizarrerie, et c’est la raison principale pour laquelle Doughty rencontra une telle difficulté à publier son texte. On en vint même à lui suggérer avec quelque insistance d’en faire une traduction… en anglais moderne. C’est d’ailleurs à une opération de cet ordre — mais en français — que s’était livré Jacques Marty dans sa traduction pour Payot : il proposait un texte rédigé dans une écriture délibérément neutre, faisant l’économie de toutes les élaborations stylistiques de l’auteur. Il va sans dire que pour une traduction intégrale digne de ce nom, il fallait prendre un parti totalement différent.
Un jeu d’équivalence aurait consisté à donner une version pastichant le français du xvie siècle, celui de Montaigne par exemple. On sait qu’il est à peu près incompréhensible pour des lecteurs d’aujourd’hui, même cultivés. La situation n’est pas la même en Angleterre où les enfants des écoles étaient (ce n’est plus guère le cas aujourd’hui) appelés à fréquenter de façon intensive les textes en « moyen anglais », depuis les contes de Canterbury jusqu’à la littérature élisabéthaine. Il en résulte une porosité apparente entre les strates de langue anciennes et modernes, qui n’est pas la même en français où un seuil manifeste est franchi avec l’institution au xviie d’une langue « classique ». Jusqu’à une époque récente, disons 1968, la règle était en effet de faire étudier lors des cours de français des années du secondaire, une pièce de chacun de trois auteurs majeurs de ce siècle : Corneille, Racine, Molière, et de faire ingurgiter aux élèves, parfois dès le primaire, avec La Fontaine, un peu de la poésie de cette période. C’était la limite extrême d’étrangeté que l’on pouvait adopter dans la traduction.
Ainsi sommes-nous accoutumés à passer de la langue classique à la langue moderne, sans solution de continuité. C’est évidemment une illusion car, sous une apparente homonymie, le sens de mots, et même la syntaxe, ont considérablement évolué12. C’était donc ce décalage-là qu’il fallait adopter pour transposer celui qui existait pour le lecteur anglais avec Doughty. Et c’est le choix que fit Jean-Claude Reverdy adoptant les mots et les tournures de la langue française d’époque classique, excluant méthodiquement tout terme ou sens que Littré signalait comme un néologisme. On avait de la sorte un ton archaïsant et cette (fausse) transparence qui existe pour les français avec cette langue, équivalente à celle qui existait pour les Anglais avec les prédécesseurs de Shakespeare.
Le travail de traduction de Reverdy allait bien sûr au-delà de ce cadre lexicologique, et visait à restituer le rythme d’écriture scandé qui était celui de Doughty, avec ses répétitions, ses assonances et ses allitérations, l’écho qu’il recherchait entre les formulations arabes et anglaises, le lyrisme aussi de cette langue finalement fleurie qui réinscrit l’auteur dans une démarche moins anachronique qu’il ne semble, puisqu’elle rejoint des tendances de l’esprit « fin de siècle » qui est son terrain réel d’inscription.
Cette traduction à laquelle il avait consacré tant années, était l’œuvre d’une vie, et le produit d’une passion. Bien que nous n’en ayons jamais parlé sur le fond, je voudrais pour finir chercher à élucider un peu les raisons de son engagement.
Jean-Claude Reverdy était un « expert », soit cette catégorie socioprofessionnelle qui a aujourd’hui un peu disparu, mais qui a fleuri dans les années de la post-colonie, avec ces organismes internationaux qui, sous la houlette de l’ONU et de la banque mondiale, s’attachaient à mettre un peu d’ordre dans l’économie de la planète. Cela concerna en particulier l’aide au développement des États du Sud et de ceux issus du démantèlement des Empires coloniaux. C’est que, faute de quelque présence permanente (comme cela avait été le cas pendant la période coloniale), il fallait envoyer en séjours de coopération plus ou moins longs des spécialistes de disciplines diverses, susceptibles d’enquêter sur les situations locales, de façon à organiser la diffusion des fonds venus des pays du Nord. Ceux que l’on missionnait ainsi pour mettre en place puis évaluer les « projets » susceptibles de réaliser ce que l’on appelait alors le développement, étaient majoritairement des ressortissants de sciences dites « dures » — principalement des agronomes, des démographes ou des économistes — mais on y trouvait aussi des ressortissants des sciences sociales à qui l’on demandait d’évaluer la part des « facteurs humains ». Cela fit vivre pendant un temps un certain nombre de sociologues et d’anthropologues mobilisés à grand prix — car ils étaient fort bien payés – pour se pencher sur la pauvreté des autres.
Ce n’était pourtant pas une condition facile que celle d’expert. On était plongé pour une durée généralement trop brève dans un milieu qu’on ne connaissait pas nécessairement, avec une marge d’intervention extrêmement limitée, ce qui était une source de frustrations terribles. Car on comprenait vite que le commanditaire était aussi le payeur, et le caractère contractuel des statuts, la nécessité d’enchaîner les contrats, constituaient, malgré les salaires qui étaient distribués — passablement mirobolants en regard de qui se pratiquait en « métropole » pour les chercheurs universitaires —, restreignaient encore les tentations que l’on aurait eu d’intervenir de façon trop critique. En fait, il leur était surtout demandé de fournir dans des délais dramatiquement insuffisants des rapports techniques favorables, appuyés sur des statistiques pour le moins fantaisistes13. Pour la bonne marche des choses, il importait de ne pas faire de vague, c’est-à-dire de ne parler ni de corruption, ni d’incompétence locale, ni de détournements à un haut niveau, ni de quoi que ce soit qui remette en cause la perpétuation du projet, lequel servait surtout à irriguer les clientèles locales et à faire que les organismes internationaux, soucieux déjà d’« humanitaire », puissent se perpétuer dans une bonne conscience mondiale.
Ces séjours étaient en outre terriblement disparates et discontinus, consistant à passer d’un continent à l’autre et retour, ce qui exigeait un effort d’adaptation important — linguistique notamment14, mais aussi personnel. Avec l’âge, cela devenait aussi épuisant que les grands décalages horaires. La solution était alors de se cantonner dans des démarches purement techniques, avec une fréquentation exclusive de services ministériels passablement anonymes, et une vie dans des hôtels internationaux qui atténuaient, par leurs puissants climatiseurs, les grands écarts de température. Ce recours était possible pour des spécialistes de disciplines classées « scientifiques », fussent-ils des hommes de terrain. C’était beaucoup plus difficile pour des sociologues se piquant d’anthropologie.
Pour atténuer les frustrations inhérentes à la situation, fort douloureuses pour un chercheur consciencieux et convaincu de l’utilité de sa mission, il y avait souvent la vie parallèle que l’on pouvait mener lors de ces excursions, en fréquentant des établissements de luxe, tripots ou bouis-bouis divers, consommant force alcool entouré de jeunes femmes peu farouches. Mais ce contrepoint n’existait pas partout, et en Arabie saoudite en particulier, ces choses étaient exclues par la morale publique, ou alors à très, vraiment très grand prix. Et puis Jean-Claude Reverdy était un paisible père de famille et, lors de ses séjours longs, il se faisait accompagner par sa femme et ses trois enfants. Ainsi, au lieu de se distraire en ville, passait-il les longues soirées tropicales sous la véranda à traduire le texte immense de Doughty.

Jean Claude Reverdy
Bien qu’il eût travaillé dans de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique du sud, il avait un tropisme pour les pays musulmans. Il avait commencé sa carrière par un séjour de plusieurs années en Algérie, dès après l’indépendance — il y avait trouvé femme —, et ses travaux avaient alors porté sur les « bidonvilles »15. Il avait ensuite enchainé sur un premier long séjour en Arabie, au sortir de quoi il fut recruté à la SOGREAH en 1969. Engageant alors une vie professionnelle itinérante, il avait successivement séjourné, disait-il, « en Tunisie, en Égypte, en Afghanistan, en Iran, aux Émirats et au Yémen du Nord ». Mais ce fut le passage en Arabie, grand séjour exotique effectué à 34 ans, alors qu’il était encore assez jeune, qui fut pour lui le plus marquant. La jubilation qu’il trouvait dès lors à la lecture de Doughty, qui l’accompagnait dans ses divers déplacements, permit de donner une continuité, et même du sens, à son existence, à sa mission. Cette traduction était l’œuvre de sa vie.
De fait, pour de mauvaises raisons sans doute, cet amateur passionné a réalisé une grande œuvre que des professionnels patentés ne sont pas parvenus à mener à bien. Car Jean-Claude Reverdy ne s’est pas contenté de se plonger dans des œuvres écrites en un anglais archaïque qui avaient servi de modèles littéraires à Doughty, il s’est attaché à éclairer le texte tant par sa traduction que par ses annotations : il y mobilisait sa connaissance des paysages et des textes, ceux de l’histoire et de l’ethnographie de la société bédouine et de l’histoire des voyages en Arabie. De ce formidable travail sortait une œuvre qui, un peu comme la grande traduction des Nuits par Antoine Galland, vient donner un supplément d’âme au texte. De fait, elle est et elle restera, sans doute pour longtemps, la seule version intégrale dans une autre langue que celle de l’auteur. Elle reste surtout la seule version lisible des Travels, toutes langues confondues
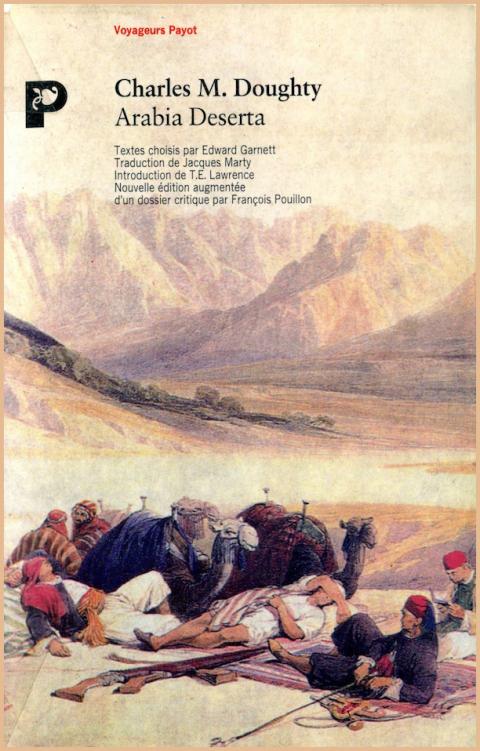
Bibliographie
Doughty, Ch. M., Travels in Arabia Deserta, Londres, Cambridge University Press, 2 t. ; 2e éd., Medici Press & Jonathan Cape, 1921 (Introduction de Th. E. Lawrence) ; 6e éd. ‘définitive’, Jonathan Cape, 1936 ; tr. fr. Voyages dans l’Arabie déserte, Paris, Karthala, 2002 (éd. J.-Cl. Reverdy).
Doughty, Ch. M., 1931 Passages from "Arabia Deserta" (Selected by Edward Garnett), Londres, Jonathan Cape ; tr. fr. Arabia deserta, Paris, Payot, 1949 ; réed. (augmentée d’un dossier critique), 1990.
Kiernan, R. H., L'exploration de l'Arabie, Paris, Payot, 1938 – éd. originale anglaise. 1937 The Unveiling of Arabia : The Story of Arabian Travel and Discovery, Londres, Harrap.
Lawrence, Th. E., 1935 Seven Pillars of Wisdom, Londres, Johnatan Cape ; réed. Penguin Books, 1962 ; tr. fr. Les sept piliers de la sagesse, Paris, Payot, 1936 ; nouv. éd. 1988.
Nordman, D., Compte-rendu de Arabia deserta, Annales ESC, 48 (5), 1993, p. 1247-1248.
Pouillon, Fr., « Doughty d'Arabie, un voyageur d'exception » et Dossier critique in Ch. M. Doughty, Arabia deserta [choix de textes], Paris, Payot, 1990, p. 331-375.
Pouillon, Fr., Bédouins d’Arabie. Structures anthropologiques et mutations contemporaines, Paris, IISMM/Karthala, 2017.
Pouillon, Fr. (dir.), Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, IISMM-Karthala, 2008 (3e éd. 2012, XXX-1073 p.).
Reverdy, J.-Cl., L'Algérie des bidonvilles : le tiers-monde dans la cité (avec Cl. Descloitres et R. Descloitres), Paris/La Haye, Mouton et Cie, 1961 (préface de Jacques Berque)
Reverdy, J.-Cl., « Charles Huber (1847-1884) », in Fr. Pouillon (dir.), Dictionnaire des orientalistes, Paris, IISMM-Karthala, 2008.
Thesiger, W., Le désert des déserts, Paris, Plon, 1982 – éd. originale anglaise Arabian Sands, Londres, 1959.
1 Doughty, 1949.
2 Doughty, 1931.
3 Lawrence, 1935.
4 Pouillon, 1990.
Ce procédé permettait de simplifier les recherches de texte suite à des renvois divers. Évacuant l’avertissement désormais obsolète d’Edward Garnett, je « trichai » sur les premières pages pour caser ma « note sur la présente édition », de façon à retomber, à partir de la page 26, sur la même pagination que l’ouvrage de 1947. À la place de la carte passablement illisible qui y figurait, je récupérai un schéma beaucoup plus clair de l’itinéraire de Doughty extrait de la traduction de la classique Exploration de l’Arabie (Kiernan, 1938, p. 285) d’ailleurs également publiée par les éditions Payot.
6 Nordman, 1993.
7 Cela avait bien gêné Marty, qui n’était pas arabisant : je donne un exemple d’une bévue à quoi cela avait donné lieu (Pouillon, 1990, p. 7, note 2) pour un texte (in Doughty, 1921, t. I, p. 273), rectifié par moi (Pouillon, 1990, p. 85), puis bien traduit par Reverdy (Doughty, 2002, p. 312).
8 Thesiger, 1982.
9 La réalisation de la maquette avec une soigneuse mise en page du texte, ainsi que l’élaboration de l’index, constituèrent par eux-mêmes des travaux considérables.
10 Celles-ci sont restées inédites, hors une notice « Charles Huber (1847–1884) » qu’il réalisa pour le Dictionnaire des orientalistes que je préparais alors avec Lucette Valensi (Reverdy, 2008).
11 C’est d’ailleurs un peu ce qui se passa pour l’index pour lequel on sollicita le grand orientaliste William Robertson Smith (1846–1894) : il est rédigé dans un anglais moins sophistiqué (et dans un arabe moins dialectal) que celui adopté par Doughty.
12 J’ai pu en faire l’expérience en Tunisie, enseignant la philosophie à des élèves tunisiens, pourtant bons francophones, en travaillant avec eux sur des textes qui nous paraissent pourtant aussi familiers que le Discours de la méthode (1637) ou le Contrat social (1762).
13 Questions analysées dans différents chapitres de Pouillon, 2017.
14 Jean-Claude Reverdy maîtrisait l’anglais et l’espagnol comme langue de travail.
15 Reverdy, 1961.
16 Lettre du 22 février 1995
https://journals.openedition.org/cy/3778
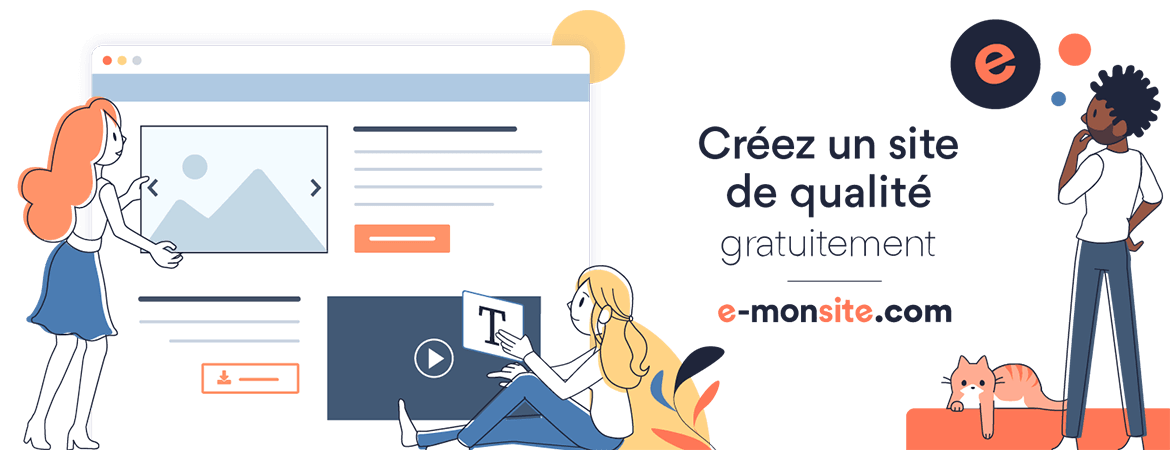

Ajouter un commentaire